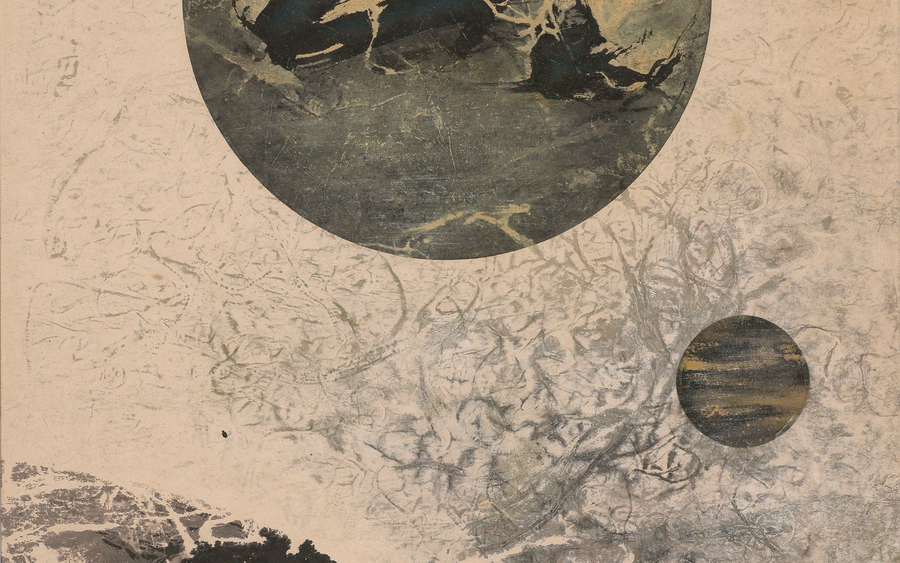Celui∙celle qui se prend à s’égarer, nez au vent, dans le très chic 8e arrondissement de Paris, à un jet de pierre de l’arc de Triomphe, aura peut-être la chance de tomber sur une vision des plus improbables : une pagode impériale chinoise rouge à trois étages, aux toits évasés et fenêtres à croisillons, nichée en plein quartier haussmannien. Construite dans les années 1920, elle abritait l’une des premières galeries spécialisées en art chinois, tenue par le légendaire marchand d’art C.T. Loo, et témoigne avec panache de la très ancienne présence chinoise à Paris.
La ville la plus visitée au monde est certes d’abord associée à la quintessence de l’élégance européenne, mais elle est aussi une bouillonnante métropole cosmopolite où se sont établis une variété de groupes culturels. L’installation d’une communauté chinoise permanente à Paris remonte à la fin du 19e siècle. Quant à celle issue de l’immigration actuelle, elle se manifeste par les deux chinatowns que compte la capitale – dans le 13e arrondissement et à Belleville – et les restaurants qui fleurissent à travers toute la ville. Aujourd’hui, à Paris, on peut trouver le meilleur de la baguette et des raviolis chinois dans un même périmètre d’à peine un kilomètre.
Cela fait plus d’un siècle que Paris attire artistes, étudiant∙e∙s et intellectuel∙le∙s venu∙e∙s de Chine en quête d’une autre inspiration, de techniques nouvelles et d’espaces créatifs en fréquentant les ateliers, les écoles et les salons de la capitale artistique de jadis. Mais à leur arrivée, les premiers d’entre eux∙elles n’étaient pas les seul∙e∙s à vouloir se faire un nom sur la scène culturelle glamour et insouciante de la Ville Lumière. À la fin du 19e siècle et au début du 20e, c’est du monde entier que les artistes affluaient à Paris pour faire leurs armes. Ceux∙celles de l’empire du Milieu débarquèrent au lendemain de la Première Guerre mondiale, notamment grâce à un programme des gouvernements chinois et français.
Dans le discours de l’histoire de l’art occidental, cette période constitue un chapitre consacré du récit de la modernité artistique. Elle est associée aux derniers feux de la peinture classique figurative et à l’avènement du modernisme. Il n’empêche : alors que le cubisme transformait le pictural en un assemblage d’éléments sculpturaux, les artistes étranger∙ère∙s continuaient d’arriver en France, et surtout à Paris, afin d’acquérir les techniques académiques de la peinture et du dessin que les groupes avant-gardistes étaient en train d’abandonner.
Les étudiant∙e∙s venu∙e∙s de Chine, par exemple, venaient apprendre les formes de représentation scientifique qui n’avaient pas cours dans la peinture traditionnelle chinoise. Pour eux∙elles, dans les années 1920, le réalisme académique, jamais pratiqué auparavant dans leur pays natal, était « moderne ». La peinture traditionnelle chinoise s’appuie sur la dextérité avec laquelle le pinceau est manié, qui vise à créer une empathie entre l’artiste et l’objet. Paradoxalement, ce n’est pas si éloigné de ce que, 30 ans plus tard, les expressionnistes abstrait∙e∙s allaient chercher à réaliser et considérer comme une innovation majeure.
Dans les années 1920, la peinture académique occidentale était centrée sur la figure humaine, souvent représentée par le nu – un sujet qui n’existait quasiment pas dans les traditions artistiques chinoises. Cela explique pourquoi le nu est récurrent dans les œuvres de ces artistes arrivé∙e∙s à Paris pendant l’entre-deux-guerres. Débarquant dans la capitale en 1921, Sanyu (Chang Yu de son nom chinois) choisit de fréquenter une école d’art privée plutôt que l’École des beaux-arts, plus traditionnelle. Un grand nombre de ses premières toiles, aujourd’hui parmi les plus prisées, ont pour sujet le nu ou des étudiantes en train de dessiner durant les cours de l’Académie de la Grande Chaumière.
S’écartant de la forme de représentation précise propre à la formation académique, Sanyu adopta un style délié et la souplesse du trait à l’encre pour suggérer les volumes. Outre d’être une source d’inspiration, les célèbres silhouettes peintes par Henri Matisse confortaient son approche « orientale » du modernisme. Pour lui, les fauves français, avec leurs amples coups de pinceaux et leurs couleurs franches, dénouaient le dilemme entre la rigueur du dessin académique et l’expressivité de l’encre chinoise. Sa manière à lui de réconcilier peinture chinoise et modernisme occidental fut la ligne d’épaisseur variable qu’il utilisait pour tracer le contour des corps. Ses contemporain∙e∙s, Lin Fengmian et Pan Yuliang (l’une des plus célèbres artistes femmes de cette époque) optèrent également pour une forme de syncrétisme pictural inspirée par les mouvements artistiques qui s’épanouissaient alors dans la capitale française. Sanyu et Pan restèrent à Paris toute leur vie, non sans difficultés financières. Aujourd’hui, Sanyu est le plus coté des artistes asiatiques modernes. Sa toile Five Nudes, réalisée dans les années 1950, a atteint le prix record de 38,8 millions de dollars chez Christie’s Hong Kong en 2019.
À l’inverse, d’autres artistes chinois∙es étudiant à Paris pendant l’entre-deux-guerres, comme Xu Beihong et Chang Shuhong, choisirent de peindre dans un style fidèle au réalisme académique et défendirent une peinture plus descriptive, privilégiant les sujets historiques et les portraits officiels. Après 1949, le réalisme académique français intégra le système d’éducation artistique de la République populaire de Chine et fusionna avec le réalisme socialiste de style soviétique pour constituer le langage visuel imposé par le Parti communiste chinois à toute production artistique.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un contingent supplémentaire d’étudiant∙e∙s formé∙e∙s en Chine dans les années 1930 par la génération d’artistes ayant séjourné à Paris arriva dans la capitale française. Même si New York était en passe de la détrôner sur la scène culturelle internationale, Paris restait une destination prisée par les artistes du monde entier pour sa tradition avant-gardiste et le non-conformisme de son milieu artistique.
C’est ainsi que Zao Wou-ki, sans doute l’un∙e des peintres chinois∙es les plus connu∙e∙s en Occident aujourd’hui, débarqua à Paris en 1948. Il avait étudié à l’Académie des arts de Chine de Hangzhou, fondée par Lin Fengmian. Walasse Ting, autre artiste reconnu internationalement, le suivit en 1952. À cette époque, l’atmosphère de la scène artistique de la capitale française avait considérablement changé : nombreux∙ses étaient ceux∙celles qui avaient rejeté le figuratif, l’abstraction leur offrant une manière de se libérer de la rhétorique des précédents styles et de la période trouble à laquelle ils étaient associés.
Pour les artistes européen∙ne∙s séduit∙e∙s par la peinture gestuelle de l’expressionisme abstrait américain, la calligraphie et la peinture d’Asie étaient une source d’inspiration. Alors qu’il∙elle∙s avaient été ignoré∙e∙s par la communauté artistique française dans les années 1920 et 1930, les artistes asiatiques accédèrent soudain au rang d’interlocuteur∙rice∙s privilégié∙e∙s, instaurant des pratiques picturales axées sur l’énergie physique du pinceau. Fort∙e∙s de cet intérêt, les artistes chinois∙es pouvaient se réapproprier leurs propres traditions tout en contribuant aux tendances artistiques contemporaines. Walasse Ting, qui entretenait d’étroits liens d’amitié avec Sam Francis et Joan Mitchell, fréquentait un groupe hétéroclite de peintres abstrait∙e∙s internationaux∙ales, parmi lesquel∙le∙s Pierre Alechinski, qu’il initia à la calligraphie asiatique. Enthousiaste, le peintre français allait par la suite intégrer des mots et des gribouillages à ses compositions. De son côté, il présenta Walasse Ting au groupe CoBrA, fondé à Paris en 1948 et considéré comme la réponse européenne à l’expressionisme abstrait.
Les œuvres de Zao Wou-ki de cette période témoignent d’un rejet progressif du figuratif pour se concentrer sur la qualité graphique de dessins à l’encre sèche qui se dissolvent dans des zones de couleurs vives. Ça et là, sans dispositions spatiales précises, des détails figuratifs parsèment ses compositions minimalistes. Les références de Zao dans ces toiles révèlent son intérêt pour à la fois l’iconographie chinoise et occidentale : elles renvoient tout autant à Paul Klee qu’à la tradition des paysages sous la dynastie Yuan, au 14e siècle.
Avec le durcissement du climat politique en République populaire de Chine et l’isolement international qui suivit le début de la révolution culturelle, en 1966, le flux d’artistes de la Chine vers Europe fut interrompu jusqu’à la fin des années 1980. La fin de la période maoïste et les réformes initiées par Den Xiaoping rouvrirent la voie vers Paris, parfois avec le soutien d’institutions françaises. À ce titre, « Les Magiciens de la terre », première exposition d’art contemporain en France à présenter des artistes du Sud global, qui se tint au Centre Pompidou en 1989, constitua un jalon. Huang Yong Ping et Yang Jiechang, tous deux aujourd’hui largement reconnus, faisaient partie de la sélection originelle. Venus à Paris pour l’occasion, ils choisirent de rester en France après les événements de la place Tiananmen, cette même année.
C’est à cette période qu’une nouvelle communauté d’artistes chinois∙es s’installa dans la capitale française, autour du critique et curateur Hou Hanru, également arrivé en 1989. Comprenant notamment Chen Zhen, Yan Pei-Ming, Shen Yuan et Wang Du, elle gagna progressivement sa place dans le paysage culturel parisien. À l’heure de la globalisation artistique, les thèmes interculturels abordés par ces artistes ne pouvaient que séduire.
L’histoire de cette communauté contemporaine d’artistes parisien∙ne∙s né∙e∙s en Chine a récemment fait l’objet d’une exposition au Musée de l’histoire de l’immigration à Paris. Intitulée « J’ai une famille », et curatée par Hou Hanru et Evelyne Jouanno, elle évoque les liens étroits qui se sont tissés entre les membres du groupe, dont beaucoup sont aujourd’hui des artistes célèbres. Comme l’écrit Hou Hanru dans un texte d’introduction, il∙elle∙s « se sont façonné∙e∙s à travers la Chine et l’Occident ». Des nus limpides de Sanyu des années 1920 au gigantesque squelette de serpent de mer de Huang Yong Ping s’étirant au beau milieu du Grand Palais en 2016, les mots de Hou Hanru sonnent juste pour chacun∙e d’entre eux∙elles.
Dr. Francesca Dal Lago est une historienne de l'art spécialisée dans l'art moderne et contemporain chinois. Basée à Paris, elle a vécu en Chine dans les années 1980 et au début des années 1990, une période de changements culturels et artistiques majeurs. Ses recherches et ses écrits portent sur les circulations artistiques de personnes et d'objets en France de la fin du XIXe siècle à nos jours.
Traduction française: Carole Coen.
Légende pour l'image d'en-tête : Vue détaillée d'une œuvre de Walasse Ting, présentée sur le stand d'Alisan Fine Arts, secteur Galleries, à Art Basel Hong Kong 2022.